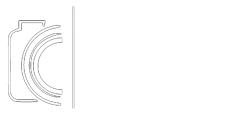Tout bouge vite en Pologne, à commencer par la capitale Varsovie, dont le développement urbain à fond de train affiche des prétentions sérieuses à compter parmi les grandes cités d’Europe. Ce voyage, effectué avec les enfants en août 2015, nous a fait traverser une bonne partie du pays, en passant également par Cracovie, la campagne profonde au pied des Carpates, et aussi le camp de Auschwitz-Birkenau.
L’Histoire n’a jamais été tendre avec les Polonais, pris en étau à de nombreuses reprises entre le marteau russe et l’enclume germanique, souvenirs pénibles de sérieuses tragédies humaines. Mais on sent un vent qui tourne et un élan enthousiaste vers l’Union européenne dont tout le pays, même gagné par de nouvelles tensions nationalistes aujourd’hui, espère beaucoup.

Varsovie est devenue en quelques années une terre de contrastes saisissants avec d’un côté le béton, le verre et les ambitions à tout crin de promoteurs fébriles et, de l’autre, les pavés, la pierre et les enduits à la chaux colorés, à retrouver dans l’étonnante vieille ville. Celle-ci a été entièrement reconstituée sous l’ère soviétique, à partir d’une vaste souscription publique. Il faut se rappeler que la capitale polonaise a été détruite à plus de 85% sous les bombes, lors de la Seconde Guerre mondiale.
Varsovie - La vieille ville




On dirait une ville figée dans la tradition austro-hongroise, avec ses accents viennois ou praguois qui fleurent bon l’Empire, quand ce dernier savait bâtir des cités magnifiques. La vieille ville de Varsovie est pourtant une création ex-nihilo intégrale d’après-guerre, bâtie à main d’homme en collant au plus près des archives mais aussi de la réalité du XVIIIè siècle telle que l’avait dépeinte en son temps Canaletto. Les tableaux du peintre italien ont été une source d’inspiration cruciale qui a permis de restituer les bâtiments, les perspectives et cette ambiance particulière qui flotte aujourd’hui. Le périmètre de la vieille ville est toutefois assez restreint et on y croise très peu de Polonais. Le caractère muséographique de la cité est d’abord un prétexte à la flânerie touristique, pour rencontrer les habitants et il faut aller dans les quartiers modernes.

Certains d’entre vous reconnaîtront peut-être ce joyau (un peu sévère, on vous l’accorde) de l’ère soviétique. « Offert » par Staline au peuple polonais en 1955, le Palais de la culture et de la science nous rappelle que dans les démocraties populaires de l’Est, on ne badinait pas avec les symboles d’autorité, y compris au nom du peuple. Ce type de bâtiment bien mastoc, haut de 231 m, est signé de l’architecte Lev Rudnev, ressortissant zélé de cette génération qui aimait se mettre au service de l’URSS et de l’idéal prolétarien. Il trouve son quasi-clone à Riga, en Lettonie, et un cousin très proche à Moscou : l’Université d’État.
Des paysages qui défilent
En rejoignant Cracovie par un train Intercités, on découvre une campagne qui, à sa façon, semble employer proportionnellement plus de bras qu’en France. On pourrait vérifier via des statistiques officielles mais c’est un fait, on voit des gens dans les champs. Le modèle dominant de l’exploitation de taille familiale a toujours fait de la Pologne un des grands producteurs d’Europe.

Des orfèvres de la construction en bois...
... qui cherchent du sel sous la terre
Très étonnante, cette mine de sel de Wieliczka, dans la banlieue de Cracovie. Inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, elle a été exploitée du XIIIè siècle à 1996, devenant par la suite une attraction majeure pour des milliers de visiteurs. Avec près de 250 km de galeries à plus de 300 m de profondeur, la mine a longtemps fourni la grande majorité du sel des Polonais, lesquels ont voué un véritable culte au lieu en lui donnant des airs de cathédrale souterraine.